La déclaration du 11 juillet 2025, portée par un groupe d’opposants qualifiés de « radicaux », a suscité en moi un intérêt particulier. Derrière les prises de position et les appels à l’action, j’ai perçu une forme de désorientation politique qui mérite une analyse dépassionnée. Car, au-delà des slogans, l’essentiel demeure : quelle est la finalité de l’action politique de l’opposition en République Démocratique du Congo aujourd’hui ? Et surtout, quelles en sont les méthodes ?
Voilà les deux axes autour desquels je propose une
réflexion critique, mais constructive. Je fais donc l’analyse de cette déclaration, et je saisis
l’occasion pour présenter ma vision.
II. Opposition politique : entre posture et projet
Il existe historiquement deux grandes voies
d’expression pour une opposition confrontée à un
pouvoir en place : la voie conflictuelle et la voie
démocratique.
- La première, radicale, prend la forme d’un
affrontement direct par les armes ou par la violence
politique. Elle considère la conquête du pouvoir
comme une fin justifiant tous les moyens, même les
plus extrêmes. Cette voie, périlleuse et souvent
contre-productive, s’inscrit dans une logique de
rupture brutale.
- La seconde, républicaine, repose sur des principes démocratiques : manifestations pacifiques, participation électorale, dialogue institutionnalisé et débats d’idées dans les médias. Elle vise non à détruire, mais à proposer, convaincre et éventuellement alterner le pouvoir par la voie des urnes.
Dans un État démocratique, l’opposition n’est pas une force en marge, mais une institution politique
essentielle, gardienne de l’alternance et force de
proposition. Elle devrait se constituer en coalition
structurée, avec des lignes idéologiques lisibles
(gauche, droite, centre, écologie, etc.), un programme commun et un pacte politique clair face à la majorité.
Ce n’est malheureusement pas le cas en RDC où
l’opposition, fragmentée et erratique, peine à se
constituer en un bloc solide. Ce manque de cohésion
favorise une instabilité politique chronique et nuit à la lisibilité de l’offre politique alternative.
A ce propos justement, l’un des maux profonds qui
gangrènent l’opposition congolaise réside dans
l’absence d’idéologie claire, de principes fermes et de vecteurs politiques structurants. Cette carence
alimente un véritable vagabondage politique, où l’on
observe des acteurs évoluer sans boussole, naviguant entre les courants au gré des intérêts personnels.
À droite le matin, à gauche à midi, au centre le soir — et finalement nulle part. Ce manque de cohérence
idéologique empêche la construction d’un projet
alternatif solide, lisible et crédible aux yeux de
l’opinion, et fragilise toute ambition de changement
durable.
Mais le constat de manque de cohérence idéologique
vaut également pour la majorité actuelle, dont la
composition hétéroclite semble davantage répondre à des logiques d’alliance circonstancielle qu’à une
véritable cohérence programmatique.
III. Les moyens d’action de l’opposition
démocratique Une opposition digne de ce nom doit articuler son action autour d’un projet politique clair. Cela implique :
1. L’élaboration d’un programme commun,
formalisé et signé par les différentes composantes
d’une coalition.
La diffusion de ce programme par des
campagnes médiatiques soutenues, des actions de
terrain, des conférences et des débats.
3. La mobilisation populaire, non par des slogans
vides ou des appels à l’insurrection, mais par un
travail pédagogique de conscientisation des
masses.
4. Le recours stratégique au dialogue, non comme
raccourci vers le pouvoir, mais comme cadre
d’influence et d’ajustement des politiques
publiques.
En clair, une opposition républicaine alterne entre la
pression citoyenne pacifique, la participation
électorale, et le dialogue responsable pour enrichir le
débat démocratique et infléchir les politiques
gouvernementales. Le dialogue, lorsqu’il est bien
structuré, peut devenir un levier d’influence, à
condition d’être pensé comme espace de négociation, et non comme voie détournée d’accession au pouvoir.
IV. Quels objectifs pour ces formes d’expression ?
Les différentes formes d’expression de l’opposition
(rébellion, marches, élections, dialogue) ne sont pas
des fins en soi. Elles visent, dans une démocratie
mature, à mettre en œuvre des réformes. Ces
réformes peuvent concerner :
- Le champ politique : révision de la Constitution de 2006, réforme du système électoral, clarification du régime politique, décentralisation véritable, etc.
Le champ économique : redéfinition des politiques
monétaires, réforme fiscale, priorisation des
investissements dans les infrastructures,
mobilisation de sources de financement durables.
Le champ social : amélioration de la politique
salariale, généralisation de la sécurité sociale, accès
universel aux services de base.
Mais pour y parvenir, encore faut-il que l’opposition
sache ce qu’elle veut, et qu’elle l’exprime de manière
intelligible et responsable.
V. Où en est l’opposition congolaise aujourd’hui ?
L’opposition congolaise semble actuellement
prisonnière d’un syncrétisme contre-productif, où se
mêlent sans hiérarchie claire toutes les formes
d’expression possibles :
Rébellion. Echec : une option désormais marginale
et condamnée par l’histoire récente du pays.
Marches pacifiques. Echec : mal organisée et peu
suivie, elle se heurte à l’indifférence populaire.
Élections. Echec : faibles résultats, traduisant un
déficit de stratégie, d’unité et d’ancrage populaire.
Dialogue. Echec : utilisé non comme instrument de
compromis, mais comme raccourci pour forcer
l’entrée au pouvoir.
- Ce mélange incohérent de méthodes nuit à la
crédibilité de l’opposition, désoriente l’opinion
publique, et donne au pouvoir en place le loisir de
gouverner sans véritable contrepoids.
VI. Conclusion : pour un sursaut politique
La démocratie congolaise est en panne de projet
alternatif structuré. Face à une opposition en échec
sur tous les fronts, la responsabilité d’initier des
réformes incombe aujourd’hui au pouvoir en place.
Celui-ci gagnerait à organiser un dialogue national,
non pas de façade, mais véritablement inclusif, pour
faire émerger une nouvelle architecture politique,
économique et sociale.
L’opposition, quant à elle, doit tirer les leçons de ses
erreurs et échecs. Si elle veut retrouver sa place dans le jeu démocratique, elle doit se doter d’un socle idéologique clair, d’un projet cohérent et d’une
stratégie d’action lucide. Il ne suffit plus de contester :
il faut proposer, convaincre, rassembler.
Les observations que je formule ici ne sauraient
exclure ni ma propre personne, ni le parti Nouvel Élan
que je représente au sein de l’opposition. Elles sont, au contraire, une invitation à un examen de conscience lucide et sincère.
- Il est temps pour nous aussi d’évaluer nos faiblesses,.de reconnaître nos échecs récents et de nous réinventer comme une véritable force de proposition, plutôt que de tomber dans le piège du simple rejet ou de la contestation systématique de l’ordre institutionnel établi.
Cet appel s’adresse également à la majorité au pouvoir, qui porte la responsabilité historique de créer un cadre inclusif capable de fédérer toutes les énergies constructives. C’est à ce prix que nous pourrons préserver la paix, renforcer la cohésion nationale et garantir une gouvernance respectueuse des valeurs démocratiques.
En définitive, cet appel s’adresse à nous tous, majorité comme opposition, au-delà de nos intérêts partisans, pour travailler ensemble à la rationalisation de notre système démocratique, dans l’unique intérêt de la République.




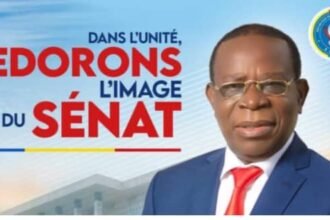
When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!